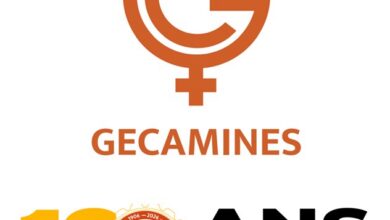Le CAJJ présente son rapport annuel sur la réinstallation des communautés affectées par l’exploitation minière au Lualaba.

Le 10 décembre 2024, le Centre d’Aide Juridico-Judiciaire (CAJJ), une organisation dédiée à la défense des droits humains, a présenté son rapport annuel portant sur la réinstallation des communautés affectées par l’exploitation minière dans la province du Lualaba, en République Démocratique du Congo (RDC). Cet événement, auquel ont participé plusieurs représentants des Comités Locaux de Développement (CLD), a permis de dresser un état des lieux des pratiques en matière de réinstallation et de compensation des populations touchées par les projets miniers dans la région.
Un rapport essentiel sur les réinstallations et la compensation
Intitulé « Exploitation minière et déplacement involontaire », le rapport du CAJJ met en lumière les pratiques actuelles de réinstallation et de restauration des moyens de subsistance des communautés affectées par l’exploitation minière. Ce rapport souligne la problématique majeure du non-respect de l’édit n°025 du 30 août 2022, qui régit les modalités d’indemnisation, de compensation et de réintégration des communautés impactées par les projets miniers. Maître Josué Kashal Avul, coordonnateur adjoint du CAJJ, a exprimé sa préoccupation quant à la non-application de cette loi, qui devrait définir des mécanismes clairs de sauvegarde des droits humains, et notamment des taux d’indemnisation et de réinstallation pour les communautés déplacées.
Pratiques de réinstallation : une gestion opaque et injuste

Les témoignages recueillis sur le terrain révèlent des pratiques problématiques dans la réinstallation des communautés. De nombreuses entreprises minières, opérant dans des zones comme Kolwezi, échouent à mener des enquêtes sociales et économiques complètes avant d’initier des projets de réinstallation. Ces enquêtes sont pourtant importantes pour évaluer les besoins réels des communautés et anticiper les impacts sociaux et économiques des projets. Parfois, les entreprises se contentent d’identifier les populations affectées et leurs biens matériels, sans approfondir les aspects sociaux et économiques. Certaines sociétés délèguent cette tâche au Comité Provincial de Délocalisation (CPD), qui souffre d’une mauvaise réputation et d’une méfiance généralisée en raison de pratiques de fraude et de manipulation. Cette situation crée un climat de frustration et de mécontentement parmi les populations concernées.
Pratiques illégales et injustices flagrantes
Des exemples concrets de mauvaise gestion des compensations ont été observés. certaines entreprises ont procédé à la délocalisation de centaines de ménages sans offrir de compensation adéquate ni de remplacement des infrastructures détruites. Au lieu de cela, les populations ont reçu des compensations financières jugées insuffisantes. Les témoignages indiquent également que la Commission Provinciale des délocalisations a prélevé une commission illégale de 10 % sur les paiements destinés aux délocalisés, ce qui a réduit d’autant plus les compensations des personnes concernées.
Manque de soutien aux agriculteurs et aux communautés rurales
Les agriculteurs, dont les terres sont souvent prises pour permettre l’exploitation minière, sont parmi les plus durement touchés. Plusieurs cas, comme celui de la communauté Noa, où les agriculteurs n’ont pas reçu de terres de remplacement malgré la perte de leurs terres agricoles au profit de l’entreprise Luilu Ressource, illustrent ce manquement. L’entreprise n’a versé que des compensations financières insuffisantes pour compenser cette perte vitale. D’autres témoignages font état de situations similaires, notamment dans le village Kalongo, où les agriculteurs ont été contraints de cesser leurs activités agricoles sans compensation adéquate ni soutien pour rétablir leur subsistance.
L’incapacité de restaurer les moyens de subsistance
L’incapacité des entreprises minières à restaurer les moyens de subsistance des communautés affectées par leurs projets est un autre problème majeur. Par exemple, les agriculteurs du village Kamboyi, déplacés en raison des activités de la société MMT, affirment ne jamais avoir reçu de soutien pour retrouver leurs sources de revenus. Dans les villages de Samukinda et Kamimbi, où l’entreprise Tengyan Cobalt and Copper Resources (TCC) a délocalisé des cultivateurs, ces derniers ont exprimé leur insatisfaction concernant les compensations qu’ils ont reçues en 2020, jugées injustes. L’absence d’un mécanisme formel pour traiter les doléances des victimes a conduit les cultivateurs à solliciter l’aide d’organisations de la société civile.
Recommandations pour une meilleure gestion des réinstallations
Face à ces défis, le CAJJ a formulé plusieurs recommandations pour améliorer la gestion des réinstallations et la compensation des communautés affectées par l’exploitation minière. Parmi les principales recommandations figurent :
- Pour le Ministre national des Mines : Adopter des mesures coercitives et punitives contre les entreprises ne respectant pas leurs obligations de réinstallation et interdire l’utilisation de compensations en argent pour la perte de terres ou de logements. Le Ministère doit veiller à ce que les entreprises respectent leurs engagements envers les personnes déplacées.
- Pour le Gouverneur de la province du Lualaba : Mettre en place une commission d’enquête interministérielle pour évaluer les pratiques de réinstallation et soutenir la diffusion et l’application de l’édit sur les modalités de compensation. Il est également crucial de renforcer les comités locaux de réinstallation.
- Pour le Ministre Provincial des Mines : S’assurer que les entreprises respectent les droits des personnes affectées par l’exploitation minière, en veillant au suivi et à l’évaluation des processus de déplacement et de réinstallation.
- Pour le Ministre Provincial de l’Agriculture : Garantir que les agriculteurs reçoivent des terres de remplacement et collaborer avec le ministère des Mines pour préserver leurs moyens de subsistance.
Bonnes pratiques de certaines entreprises
Maître Josué Kashal a également souligné que certaines entreprises, comme Kamoa, Metalko et TFM, se sont distinguées par leurs bonnes pratiques en matière de réinstallation et de soutien aux communautés affectées. Ces entreprises ont respecté leurs engagements, contribuant ainsi à la restauration des moyens de subsistance des populations locales.
Conclusion

En conclusion, bien que des progrès aient été réalisés dans certaines entreprises, la gestion des réinstallations et des compensations des communautés affectées par l’exploitation minière au Lualaba reste globalement insuffisante. Un suivi rigoureux, une transparence accrue et un mécanisme de règlement des conflits sont essentiels pour garantir que les droits des populations affectées soient respectés et que leurs moyens de subsistance soient efficacement restaurés.